Il était une fois LLG ... Sylvie Kandé
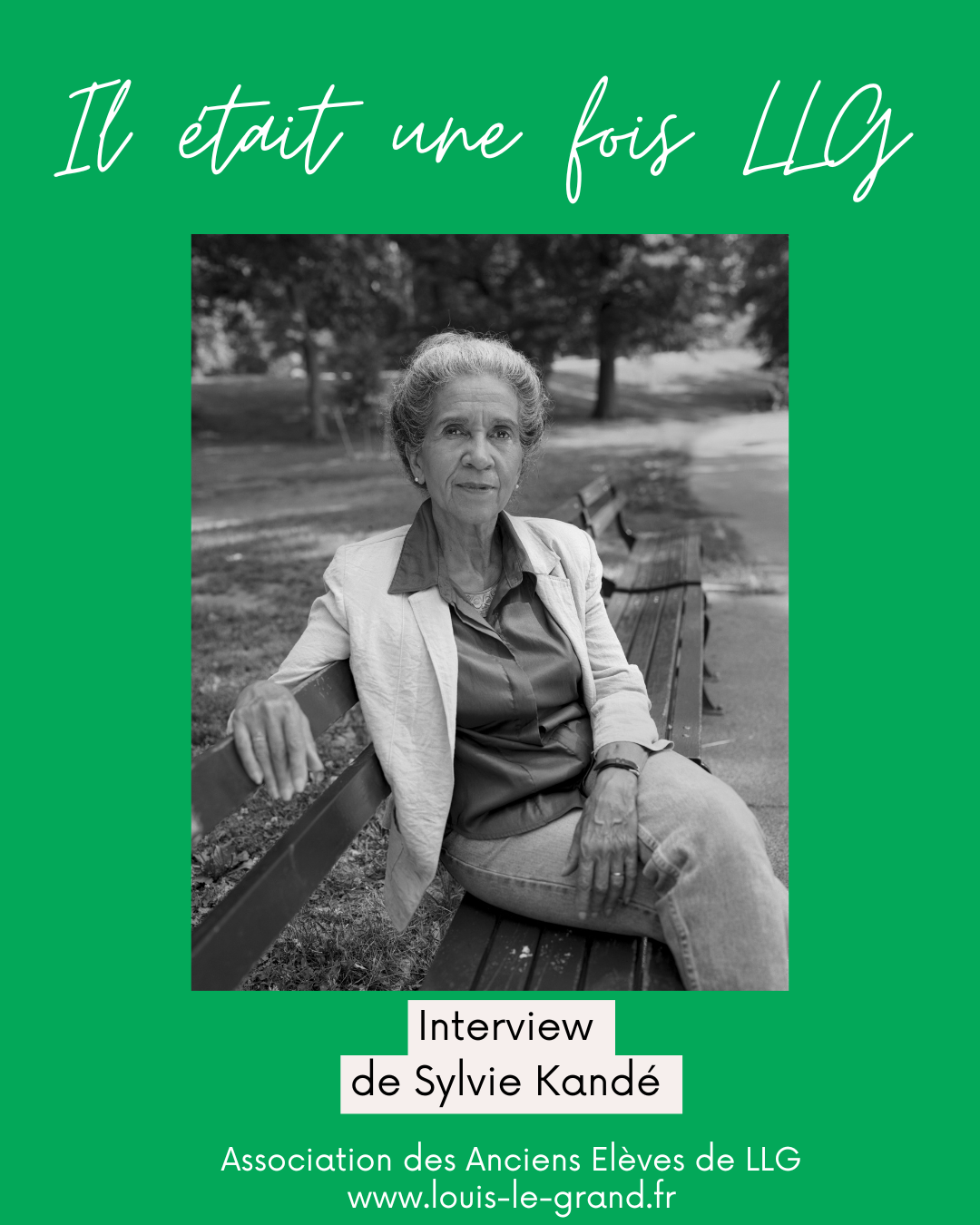
Il ÉTAIT UNE FOIS LLG
Interview de Sylvie Kandé (LLG 1977)
Par Aïna Adlerberg Douady, doctorante en sciences politiques à Université Paris Cité (LLG 2012)
"je vois le lycée Louis-le-Grand essentiellement comme une matrice de personnalités, de références et de souvenirs qui me sont chers."
Avant d'être poétesse, écrivaine et enseignante de littérature africaine et caribéenne francophone à New York, Sylvie Kandé a été élève en hypokhâgne et khâgne au Lycée Louis le Grand. Voici un rapide retour sur l'expérience qui fut la sienne.
Comment êtes-vous arrivée à Louis-le-Grand ? Était-ce votre choix ?
Mon parcours a obéi à sa logique propre. Au Lycée Marie Curie de Sceaux, j’avais choisi la voie littéraire en 3ème et ce, sans obligation aucune, inspirée sans doute par d’excellents enseignants tels que Mademoiselle Vidal, une professeure de lettres dont je garde un souvenir ému. Ajoutons qu’à l’époque, les humanités avaient encore un prestige certain, mais fragile en comparaison des mathématiques “modernes”, des sciences et de la technologie.
C’est au modèle senghorien que j’attribue ma prédilection pour les lettres classiques. Léopold Sédar Senghor préconisait l’apprentissage du grec et du latin, rappelant qu’il devait l’amélioration de sa condition, peut-être même sa survie, à l’admiration du commandant du camp de prisonniers où il avait été transféré en 1941 pour un soldat qui lisait Platon dans le texte. Senghor célébrait aussi “ les liens privilégiés que le monde noir n’a cessé d’entretenir avec le monde méditerranéen ”[1], intuition qui faisait grand sens en général et tout particulièrement pour moi qui cherchais à m'émanciper des limites du binaire.
Il se trouve que le grec, contrairement au latin, n’était pas enseigné au secondaire dans mon lycée de banlieue. Je m’y suis donc initiée avec des amis de mes parents, puis j’ai pris des cours particuliers, redoublant d’efforts de mise à niveau lorsqu’en 1975 j’ai reçu ma décision d’admission au Lycée Louis-le-Grand — ce dont j’étais ravie mais peu surprise puisqu’il fallait en amont constituer un dossier d’admission en classes préparatoires.
Comment vous êtes-vous senti accueillie ? Quelles furent vos premières impressions ?
L’un des aspects de l’enseignement supérieur en France que j’ai le plus apprécié, c’est justement l’absence de cérémonie d’ouverture ou de clôture de cycles. Plutôt qu’ “ accueillie ” à Louis-le-Grand, j’ai été mise en présence d’enseignants hors-pair et d’élèves motivés qui partageaient mon goût des humanités, de l’histoire et des langues. Je me suis sentie embarquée dans un mouvement d’idées qui avait commencé avant moi et continuerait bien après, et ce, sans que je sois sommée de légitimer ma présence.
L’environnement, plaisamment austère, ne trichait pas : il était à l’image du style de vie qu’on nous invitait à mener pour réussir. Les cours étaient intenses, saturés, ce qui n’était pas pour me rebuter.
En dehors de connaissances académiques, qu'avez-vous retenu de « l’école Louis-le-Grand » ?
Je souhaitais entrer à Louis-le-Grand pour des raisons académiques et, de cette école, j’ai essentiellement retenu des contenus ou des méthodes académiques ainsi que le goût pour la réflexivité. J’ai d’ailleurs continué à faire mon miel de cet enseignement, notamment en ce qui concerne les lettres classiques. Le mémoire de maîtrise que j’ai rédigé concerne les représentations de l’Afrique dans l’art et la littérature grecs de la période classique ; il y a quelques années, j’ai écrit un court essai sur “Cicéron et les sans-papiers” à l’occasion d’une conférence sur l’immigration ; j’ai encore commenté le lien que je voyais entre Kane, Kundera et Parménide pour l’Atelier du roman, et j’attends la parution d’un texte plus long, de l’ordre de l’autobiographie intellectuelle, intitulé “Les bibliothèques intérieures d’une Afro-grecque”.
Spécialiste d’histoire africaine, je viens de demander à enseigner un cours d’histoire grecque et romaine, ce qui me permet de me réinvestir dans une période, des cultures et des philosophies que j’avais fréquentées à Louis-le-Grand, tout en mettant à profit mon détour par l’épistémologie postcoloniale.
-
Quel échec (ou réussite) vous a fait le plus avancer ?
L’échec meurtrit et n’apprend rien ou pas grand-chose : je tends à m’insurger contre cette “positivité toxique” qui voudrait nous faire accroire que coups et blessures sont salutaires. Ce que j’ai réussi, je crois, c’est d’avoir fait miennes, littéralement, les exigences des classes préparatoires. J’en garde un goût immodéré pour le travail intellectuel et artistique au point de trouver pesants ou futiles d’autres aspects, même essentiels, de l’existence. Il me semble que le temps me talonne de plus en plus pour que je parvienne à “ finir le programme ”.
- Si vous le pouviez, qu’aimeriez-vous dire à la jeune lycéenne que vous étiez ?
Une très belle phrase de Cheikh Hamidou Kane, ancien élève de Louis-le-Grand lui aussi et auteur de L’aventure ambiguë, me revient en mémoire :
“ La courge est une nature drôle. Jeune, elle n’a de vocation que celle de faire du poids, de désir que celui de se coller amoureusement à la terre. Elle trouve sa parfaite réalisation dans le poids. Puis un jour, tout change. La courge veut s’envoler. Elle se résorbe et s’évide tant qu’elle peut. Son bonheur est fonction de sa vacuité, de la sonorité de sa réponse lorsqu’un souffle l’émeut. La courge a raison dans les deux cas.” (43-33)
La jeune étudiante que j’étais, sept ans après mai 68, et l’écrivaine, la mère que je suis aujourd’hui, dans un espace culturel tiers, avec un accès au numérique quasi-illimité, n’ont guère de terrain commun où converser : chacune a raison, chacune a ses raisons.
Quels amis fréquentiez-vous ? Et qu’est-ce qui vous manque le plus dans vos amitiés de cette époque ?
Tout en fréquentant le Lycée Louis-le-Grand, j’avais conservé des relations plus anciennes et j’en ai noué d’autres en dehors de l’établissement. Quant à mes amitiés à Louis-le-Grand même, elles se sont paradoxalement développées beaucoup plus tard.
Je vois régulièrement Souleymane Bachir Diagne à des événements organisés à Columbia University où il enseigne. Nous avons participé à des conférences ensemble, notamment à Harvard en 2006 sur le thème de “Senghor, the Ancestor” et en 2022 à Paris-Est Créteil pour un hommage à Papa Samba Diop. Nous avons publié nos hommages respectifs à Édouard Glissant dans un numéro spécial d’Africultures de 2012.
J’ai eu le plaisir de lire certains des travaux d’Éric Vial qui mène une recherche tout-à-fait innovatrice, entre autres sur l’uchronie. Il m’a incitée à participer au numéro 12 d’Écrire l’histoire : à cette occasion, j’ai travaillé sur une nouvelle assez peu connue de Sembene Ousmane ainsi que sur mon second recueil poétique, La quête infinie de l’autre rive. Épopée en trois chants (Gallimard 2011).
J’ai revu Alain Ménil du côté du Centre Pompidou un peu avant son décès : il m’a remis son essai philosophique sur Édouard Glissant, ce magistral ouvrage intitulé Les voies de la créolisation (De l’incidence, 2011). Je regrette amèrement de ne pas avoir eu le temps d’approfondir avec lui la réflexion sur le métissage que nous avions entamée ni de continuer à l’interroger sur les travaux de son grand-oncle, René Ménil, ami de Césaire.
De la période Louis-le-Grand, ce qui me manque surtout, c’est son atmosphère d’effervescence intellectuelle ainsi que les lieux de rencontre entre étudiants. Même aujourd’hui, les cafés parisiens me paraissent curieusement beaucoup plus funky et fédérateurs que ne le sont beaucoup de coffee shops à New York. On se réunissait au Soufflot assurément, auMalebranche peut-être, sur lequel j’ai écrit une sorte d’élégie.
Quels sont les professeurs qui vous ont aidée, marquée ? Que vous disaient-ils à l’époque ?
Je me souviens davantage (ce qui est parfaitement injuste) des enseignants dans ma spécialité. Avec leurs personnalités hors du commun, ils m’ont convaincue de l’importance de la dimension performative en matière d’enseignement. Tous avaient un profond respect pour les mots sur la page où l’interprétation devait obligatoirement s’ancrer : “coller au texte” était la règle d’or. Elle me guide toujours, même si j’admire les exercices de haute voltige de certains critiques qui décollent du texte avec brio pour mieux s’attacher à sa vérité latente ou codée.
Grâce à Éric Vial, j’ai pu retrouver les noms de deux professeurs, brillants et bienveillants à la fois : il s’agit de M. Richet, professeur de latin-grec et de M. Debussy, professeur de lettres qui me disait que j’étais “une valeur sûre”.
Et la sentimentalité ? Etiez-vous amoureuse à l’époque du lycée ?
La période Louis-le-Grand, c’est la découverte des bibliothèques de recherche comme Sainte-Geneviève. Les bibliothèques restent pour moi une grande passion. Sentir l’odeur du bois et du vieux papier — celle qui me ravissait à Sainte-Geneviève, que j’ai retrouvée à l’Arsenal et que je sens encore à la Butler Library de Columbia U. —, pouvoir effleurer les reliures des livres, chercher son chemin dans la pénombre des rayonnages sont des expériences véritablement sensuelles. Et pour avoir éprouvé la jubilation de découvrir le document, la ligne qui fait aboutir ou relance une recherche, je porte le deuil de la disparition de la bibliothèque d’Alexandrie, des effets du séisme de 1755 sur la bibliothèque royale de Lisbonne, des perturbations causées à l’Institut des hautes études et des recherches islamiques Ahmed Baba à Tombouctou, entre autres.
Ce que j’aime dans les bibliothèques, c’est aussi la tension qu’on y perçoit entre le désir de classification et son impossibilité — un thème qui court dans la nouvelle de Borges, “ La bibliothèque de Babel ” et resurgit dans le roman d’Eco, Le Nom de la Rose.
Quel message souhaiteriez-vous communiquer aux jeunes qui sont en ce moment à Louis-le-Grand ?
Un enseignement de premier ordre, tel que celui que j’ai reçu à Louis-le-grand, offre des outils non seulement pour l’intelligence et la mémorisation des matériaux et méthodes, mais aussi pour la production, le raffinement et la déconstruction du savoir. Il prépare et appelle même son dépassement.
Le recours “facile” à l’intelligence artificielle peut mener aux antipodes de cette définition, même si par ailleurs l’IA ouvre des possibilités immenses dans certains domaines, en médecine, ou en archéologie où elle permet par exemple de décoder, grâce à des algorithmes, des textes sur rouleaux anciens sans briser ces derniers en tentant de les desceller.
En outre, il me semble important non pas tant d’appliquer le savoir acquis que de l’impliquer dans (littéralement, de le mettre dans les plis de) l’action, de le mettre au défi de ses fins. Ce faisant, on repère mieux, dans nos constructions, cohérences et surtout dissonances, lesquelles ne sont pas forcément à réduire mais à considérer.
Que pourrait vous permettre l’Association ?
C’est M. Daniel Cabou, dont j’ai lu le bel entretien sur “Il était une fois Louis-le-Grand”, qui m’avait encouragée à faire partie de l’Association des anciens élèves de Louis-le-Grand : je lui en sais gré.
L’Association m’a permis de rencontrer, sur une base de confiance immédiate, des personnes au parcours extraordinaire telles que vous-même, et aussi de contribuer au Fonds de solidarité à destination des étudiants. Il avait été question que je fasse un exposé à un gala de fin d’année, projet qui se matérialisera sans doute dans un prochain avenir.
Ma démarche n’est en tous cas pas utilitaire : je vois le lycée Louis-le-Grand essentiellement comme une matrice de personnalités, de références et de souvenirs qui me sont chers.
[1] L.S. Senghor “La place des langues classiques dans les humanités sénégalaises ”. Bulletin de l’Association Guillaume Budé, 1979, 2, p 164.
Actualités
- Dîner de gala 2025 :
- Diner de gala 2024 - Samedi 14 décembre 2024 à partir de 18h15
- Jeudi 22 février à 18h - Mes rencontres avec Michel Serres, conférence de Patrice Dalix
- Afterwork 18 janvier 2024
- Concerts 100% Mendelssohn avec Les Déconcertants
Chargement : 36 ms






