Il était une fois LLG ... Souleymane Bachir Diagne
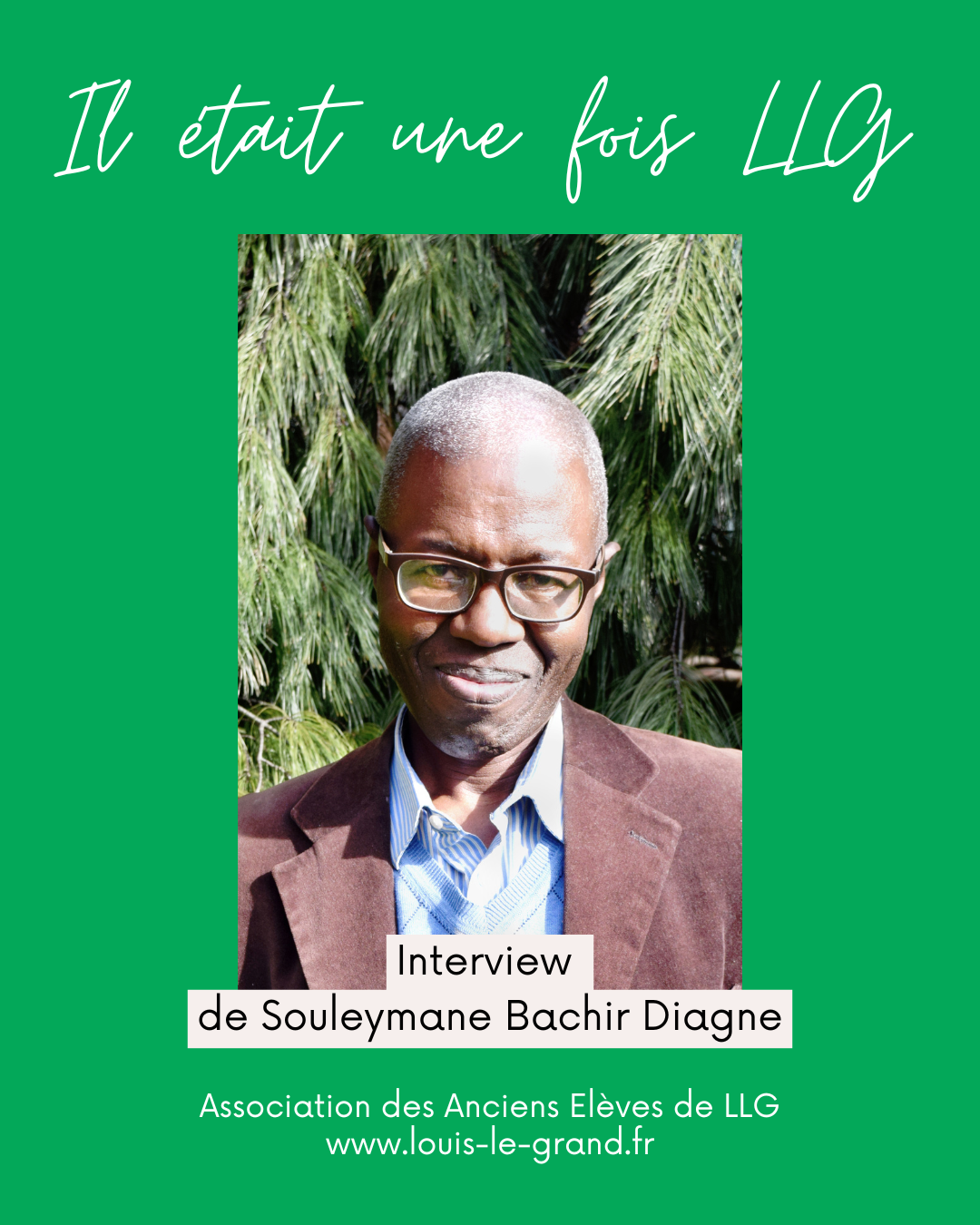
Il ÉTAIT UNE FOIS LLG
Interview de Souleymane Bachir Diagne (LLG 1977)
Par Aïna Adlerberg Douady, doctorante en sciences politiques à Université Paris Cité (LLG 2012)
Avant de devenir philosophe et professeur de philosophie et de français à l’université Columbia à New York, Souleymane Bachir Diagne fut élève en classes préparatoires littéraires (hypokhâgne et khâgne) à Louis-le-Grand (1977). Voici l’expérience qui fut la sienne.
« C’est important de dire que c’est à LLG que j’ai noué les plus solides amitiés qui ont maintenant plus de cinquante ans.»
1. En trois mots, l’expérience à Louis-le-Grand (LLG) :
Quand je suis arrivé au lycée Louis-Le-Grand en hypokhâgne, la rentrée avait déjà eu lieu. Je venais de Dakar et il n’y avait pas encore de places dans les dortoirs. Au moment de la rentrée, des matheux attendaient encore les résultats et les propositions qu’ils allaient avoir en fonction des démissions dans les écoles d’ingénieurs. Cela allait se dégager en quelques semaines, mais il y avait encore un certains nombres d’étudiants qui n’avaient pas de places dans les dortoirs. C’est comme cela que je me suis retrouvé à habiter à l’infirmerie. Mon premier souvenir au lycée Louis-Le-Grand était donc d’habiter à l’infirmerie, où j’ai d’ailleurs rencontré un autre étudiant, en hypotaupe (maths sup), qui venait du Niger et qui était d’origine iranienne, et qui est depuis devenu mon meilleur ami. Voilà comment s’est fait mon premier contact au lycée Louis-le-Grand. J’ai eu ensuite une place dans les dortoirs. Je suis sûr que beaucoup de gens de ma génération qui ont déjà fait des entretiens ont parlé de la nature des dortoirs à l’époque. Aujourd'hui, je sais que le lycée a de nouvelles chambres. Pour nous, c’était des box, une grande salle avec des box séparés par des cloisons en bois, avec un tout petit lit et une petite table, etc … Les mots clés de mon premier contact avec LLG, arrivant de Dakar sont :
- infirmerie
- dortoir
- box
2. La décision de postuler à Louis-le-Grand :
Je suis Sénégalais, et les Sénégalais de ma génération ont souvent entendu parler de LLG pour la raison suivante : Léopold Sédar Senghor, qui était le premier Président du Sénégal et le premier Président à l’époque où je venais d’avoir mon bac, avait été élève à LLG. C’est d’ailleurs à LLG qu’il a rencontré quelqu’un qui allait être un de ses meilleurs amis, ainsi que celui qui allait être le futur Président de la France, Georges Pompidou. C’est également à LLG qu’il a rencontré Aimé Césaire, avec qui ils allaient fonder dans les années 1930 le mouvement de la Négritude. LLG était évidemment très présent dans sa trajectoire, et il en parlait souvent. Tous les Sénégalais, et en particulier, les jeunes élèves de ma génération connaissaient LLG, savaient qu’il était le plus grand ou l’un des deux plus grands lycées de France pour les classes préparatoires. Quand il s’agissait de poser ma candidature en classes préparatoires, avec mon père, c’est donc tout naturellement que nous avons présenté un dossier à LLG.
3. Les premières fois à Louis-le-Grand, les premiers étonnements :
Un autre fait marquant était la rencontre avec les nouveaux élèves, les camarades que j’ai commencé à me faire tout de suite en arrivant, avec qui je partageais l’amour du football. Ce sport a cimenté mes amitiés à LLG, des amitiés que je garde encore. Mes meilleurs amis, aujourd’hui, quand je viens en France, avec qui je me retrouve avec grand plaisir sont ceux que j’ai eus à LLG. J’ai connu certains d’entre eux à l’École Normale Supérieure, où nous nous sommes retrouvés après les concours. D’autres n’ont pas intégré ou sont allés ailleurs, surtout parmi les matheux. Mais c’est important de dire que c’est là que j’ai noué les plus solides amitiés qui ont maintenant plus de cinquante ans. Évidemment, quand on est en classes préparatoires, on a le sentiment d’être dans une structure très compétitive, où les gens se sentent en rivalité. En fait, pas du tout ! Nous avions et le football et la politique pour créer des liens. Et c’est le souvenir que j’ai de LLG : des amitiés magnifiques, solides, qui durent encore aujourd’hui et qui se sont nouées autour de l’amour en commun du football, et un engagement politique, disons à gauche. On jouait dans la cour que l’on voyait au-dessous de soi quand on montait au premier étage. On se retrouvait aussi dans les terrains de Paris, où l’on essayait d’avoir des activités plus suivies.
4. Les graines semées par Louis-le-Grand qui ont germé
Dans mon cas précis, c’est l’amour de la philo. J’ai eu les meilleurs profs possibles. L’un d’entre eux, en particulier, a beaucoup compté pour moi et pour beaucoup de gens de ma génération : le professeur de philo André Pessel. De Comte-Sponville à Kambouchner, nous avons tous été très profondément marqués par ce professeur. J’en parle parce que j’ai le sentiment qu’il a joué un peu pour notre génération le rôle que le philosophe Alain a joué pour beaucoup de philosophes des générations antérieures. J’ai eu le meilleur enseignement dont on peut rêver dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture de la philosophie, dirais-je. Il nous a appris à lire des textes. Cela a l’air de rien, dit comme ça, mais c’est très important: se bagarrer avec un texte, ne pas aller directement vers les grands concepts philosophiques, auxquels on a tendance à réduire certains textes. Prenons un exemple : quand on lit Descartes, on va vers le doute, puis l’hypothèse du malin génie, et puis on sort du doute etc … Le parcours conceptuel est bien balisé. Pessel est quelqu’un qui invitait par exemple à faire attention à la fin de la première méditation de Descartes, où le sujet qui parle, celui qui dit “je”, dit “maintenant je suis fatigué, je vais aller dormir parce que l’entreprise de méditer m’a fatigué”. Il a tiré de ce texte-là ce côté inattendu, où il allait faire tout un développement sur le désir d’illusion. Voilà un philosophe qui décide de se débarrasser de tout ce qui est douteux, et qui à la fin de sa démarche, au terme de la première méditation, dit “je vais me coucher, et j’espère que je vais rêver et que cela va me reposer etc …” . Cela veut dire qu’en même temps qu’il dissipe les illusions de connaissance pour trouver la vraie connaissance, il reconnaît à la fin de la première méditation la douceur qu’il y a dans l’illusion. Voilà le genre de chose que Pessel allait lire dans un texte. Il préparait bien ses cours évidemment, mais lui-même découvrait, au moment où il nous en parlait, quelque chose, un angle particulier dans un texte, et là il s’extasiait. Il disait “Mais il est fabuleux ce texte !”. C’était une phrase typiquement pesselienne : “Il est fabuleux ce texte”, une manière de s’enthousiasmer pour les textes de philosophie et de partager son enthousiasme avec nous. C’était un peu ça, la personnalité d’André Pessel. C’est la raison pour laquelle il a beaucoup marqué de cohortes de lycéens en classes prépa et à l’École normale, pour ceux qui y sont allés.
5. Le plus beau souvenir à Louis-le-Grand :
Les souvenirs liés à LLG même et aux études étaient évidemment les cours avec André Pessel. Un grand moment d'excitation intellectuelle ! Et puis il y a tous les souvenirs que nous avons partagés avec les amis de l’époque : les booms, les voyages ensembles, chez un tel ou un tel, on allait se retrouver pour aller danser, etc … Ce sont de beaux souvenirs aussi. On s’amusait beaucoup en classes préparatoires. On n’était pas en permanence focalisé sur le petit grec et le petit latin, on passait beaucoup de temps à ce genre d’activité, en effet. À l’époque, j’aimais aller écouter du jazz au caveau de la Huchette. Les booms, nous les faisions chez les uns ou les autres. C’est plus tard, à l’École Normale qu’on allait en boîte, dont les plus en vue de l’époque, étaient les Bains Douches et le Palace.
6. Les rencontres marquantes de Louis-le-Grand :
Comme les cohortes se chevauchent, j’ai connu des gens qui sont devenus de grandes personnalités dans le monde académique. J’ai parlé tout à l’heure de Comte-Sponville, qui était en dernière année, quand moi j’étais en hypokhâgne, ou encore de Kambouchner. Je pense aussi à Gilles Jacquin de Margerie qui a fait l’ENA, puis le Conseil d’État. Il y avait aussi la fille du sociologue Alain Touraine, Marisol. Je ne me souviens plus exactement si j’avais déjà rencontré certains d’entre eux à LLG, ou seulement après, à l’École Normale. C’est à ce moment-là, en tout cas, que j’ai rencontré des philosophes qui sont plus tard devenus connus.
7. L'excellence des professeurs :
Celle d’André Pessel ! Il y en a eu d’autres, en khâgne : Hubert Grenier, qui m’a beaucoup marqué, et Aldebert en histoire. Tous ont été marquants. Mais je dirais que Pessel et Grenier ont contribué en grande partie à ma propre trajectoire. Je peux encore les entendre nous expliquer tel ou tel élément de cours. Ils étaient tous les deux des profs de khâgne en spécialité.
8. La méritocratie à la française :
Bonne question ! C’est toujours le dilemme avec les classes préparatoires. La méritocratie est censée être un principe d’égalisation. C’est par le mérite que la réussite sera au bout. Malheureusement, cela ne fonctionne pas ainsi car les inégalités s’établissent relativement tôt. On veut croire à l'égalité des chances, qui reste quand même une illusion, dans la mesure où, au départ, les dés sont pipés. Si l’on regarde les chiffres de ceux qui sont arrivés en classes préparatoires, on se rend compte qu’il y en a beaucoup de ceux dont parlent Bourdieu et Passeron dans les Héritiers. Ce sont des “héritiers” qui se retrouvent là, qui ont un bagage, un capital culturel assez important. Et donc, moi, arrivant du Sénégal, on aurait pu penser que je n’avais pas le même bagage culturel que mes camarades se trouvant là, dans un système qui n’était pas le mien, dans un pays qui n’était pas le mien. Or c’est là que se trouve la force de Senghor, qui a connu cet univers-là : il avait établi au Sénégal tout un système éducatif. Il veillait sur la politique éducative de son pays comme sur la prunelle de ses yeux. D’ailleurs, quand je suis entré à l’École normale et que je suis revenu à Dakar, il m’a reçu personnellement pour me féliciter en me disant : “vous êtes le fruit de ma politique”. Cela veut dire que j’ai fait moi-même, au fond, l’expérience de ce que cela veut dire d’avoir, au départ, le capital culturel nécessaire pour l’arrivée en classes préparatoires. C’est donc vrai, il y a toujours la possibilité pour des fils d’ouvriers de s’élever grâce à leur mérite propre, mais la connexion que l’école ou la méritocratie devrait apporter ne fonctionne pas toujours aussi bien qu’on pourrait le souhaiter pour combler les inégalités.
9. Les messages aux élèves actuellement à Louis-le-Grand ?
Tout d’abord, je suis heureux de découvrir cette initiative et le fait que les élèves, anciens et actuels, aient le sens d’une forme de continuité. Il est toujours très important de conserver le sens de la profondeur historique. J’avais d’ailleurs dit que ma propre décision d’aller à LLG devait à l'histoire de ce lycée. Et le fait que son histoire était liée à l’histoire personnelle de celui qui allait devenir le premier Président du Sénégal. Il est donc important d’avoir le sens de sa propre histoire. Les élèves actuels vivent dans des conditions qui sont totalement différentes de celles qui ont été les nôtres. J’ai parlé des box, ils ont disparu depuis, mais même les types de concours que l’on passait à l’époque étaient différents de ceux d’aujourd’hui. Je ne parle que des classes préparatoires, car je n’ai pas connu le lycée de la Seconde à la Terminale.
- Les attentes vis-à-vis de l’association des anciens élèves
Avoir le sentiment d’une histoire, d’une évolution du lycée où l’on a vécu et des moments importants. C’est là où j’ai noué des amitiés les plus durables, les plus fortes, et qui sont encore les miennes à ce jour. Ce n’est pas que le caractère compétitif, c’est aussi de profiter, de côtoyer des gens brillants et intéressants, et d’être surtout attentif à l’amitié.
Actualités
- Dîner de gala 2025 :
- Diner de gala 2024 - Samedi 14 décembre 2024 à partir de 18h15
- Jeudi 22 février à 18h - Mes rencontres avec Michel Serres, conférence de Patrice Dalix
- Afterwork 18 janvier 2024
- Concerts 100% Mendelssohn avec Les Déconcertants
Chargement : 25 ms






